|
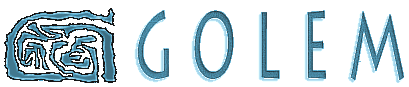

« Jewish Disneyland » – appropriation et spoliation
de « ce qui est Juif »
[English]
[French] [German]
Iris Weiss
Pitigliano – une ville au sud de la Toscane avec un passé
juif impressionnant. La minorité juive atteignit dans cette ville jusqu'à 20%
de la population. Aujourd'hui la synagogue est devenue une attraction
touristique. La seule personne qui vient régulièrement afin de prier, habillée
d'un tallit, est catholique. L'offre standard pour les touristes ne comprend
pas seulement du vin casher mais aussi des gâteaux, qu'Elena Servi la dernière
personne juive de la ville, confectionne selon une vieille recette familiale.
Pour la préparation du projet d'exposition « Paradiso@Diaspora », présenté
avec la collaboration d'artistes juifs italiens, le groupe Meshulash a été
clair : des projets analogues sont organisés dans d'autres lieux en Europe.
Diana Pinto, dans son essai « Vers une identité juive européenne », paru dans
le Golem 1/1999, l'avait bien signalé : « Le troisième et plus difficile défi
concerne les ‹ espaces juifs › (Jewish spaces). Comment les Juifs peuvent-ils
s'impliquer et intervenir dans les ‹ espaces juifs › qui voient le jour en
Europe alors que ces espaces sont de plus en plus fréquemment l'objet
d'initiatives de non-juifs qui en constituent la majeure partie des visiteurs
voir même des gestionnaires. »
Prenons l'exemple de Berlin : nulle part ailleurs le mythe de la « judéité »
n'est mis en scène et célébré avec autant d'excès que dans la Oranienburger
Strasse. Situé au cœur de Berlin-Est, ce quartier était à l'abandon avant la
chute du Mur. Une architecture d'avant-guerre, entre-temps souvent restaurée,
a donné un air désuet à ce quartier et contribué à attirer un flot de
visiteurs, mais aussi des artistes, des agences de publicité, etc. Ainsi un
quartier vit le jour dans une multitude de galeries d'art, librairies,
boutiques de luxe, cafés, clubs et restaurants... Le temps semblait s'être
immobilisé là et facilitait pour de nombreuses personnes l'approche de
l'histoire juive, grâce à la présence de multiples lieux juifs encore visibles
( ruine de la synagogue, ancienne école, cimetière )
De façon croissante sont apparus des simulacres de « vie juive » qui ont
conduit à se poser la question suivante :
Comment et où se montre la « ce qui est Juif » dans la topographie urbaine, et
qui prend position à son sujet et de quelle manière ?
Parmi les « ingrédients » de ce pot-pourri on trouve des restaurants comme le
« Mendelssohn », où l'on sert régulièrement des plats avec de la viande de
porc accompagnés d'une sauce à la crème ; des concerts de musique klezmer
bondés, ainsi qu'un grand éventail de films et de lectures publiques. Ce
programme est complété par une multitude de visites guidées. En réalité, on
s'aperçoit souvent que les organisateurs de tout ceci ne connaissent pas
personnellement de juifs et n'estiment pas qu'il leur soit indispensable de
connaître les différents aspects de la vie juive.
Quelles images des Juifs et de la vie juive peuvent être ainsi transmis ?
Quels clichés sont ainsi véhiculés et amplifiés jusqu'à influencer la
perception quotidienne ? En premier, on retrouve le mythe du « Juif riche » :
Devant le bâtiment de la « Ahawah », un ancien orphelinat juif qui était
plusieurs années encore après la réunification une école publique pour
non-voyants, on entend lors d'une visite guidée « qu'en 1991, la communauté
juive a expulsé les enfants du jour au lendemain afin de conclure un contrat
lucratif avec une agence de publicité. »
Parfois, la réalité est plus riche que la fiction. Sur le marché de Noël
écologique de la Sophienstrasse, un samedi, trois trombonistes en manteaux
noirs avec des chapeaux jouent des chants de Noël. Une passante commente : «
C'est beau que les Juifs jouent ces airs-là ». Son compagnon ajoute : « Ce
sont ceux qui d'habitude jouent du klezmer . »
Quelle nécessité peut bien se cacher derrière cette quête de « ce qui est Juif
» ? Ces « mises en scènes » sont-elles plutôt à prendre comme l'expression des
non-Juifs quant à leurs propres fantasmes ? Il faudrait garder l'esprit
critique et préciser que parfois même des Juifs participent à ce « Jewish
Disneyland », et ceci pas seulement à Berlin.
En Italie, le chanteur et comédien Moni Ovadia, né en Bulgarie et ayant grandi
dans la péninsule, a beaucoup de succès. Il popularise essentiellement la
culture du Shtetel d'Europe de l'est, qu'il fait passer auprès de ses
auditeurs comme étant la vie authentique juive en Italie. Lui-même,
appartenant à la culture séfarade comme l'Italie, a appris à connaître à l'âge
adulte seulement des survivants juifs originaires d'Europe de l'Est. La
formidable résonance auprès du public correspond à un vide réel. Son yiddish
est pauvre – comme celui d'une personne de langue maternelle yiddish qui
tenterait de parler italien. En Allemagne aussi, les manifestations
culturelles, dans lesquelles les apports d'artistes juif-allemands sont mis en
avant comme acteurs de la vie culturelle, ne rencontrent, en comparaison, que
peu d'échos, sauf peut-être à l'occasion d'un jubilé, comme par exemple celui
du centième anniversaire de la naissance du compositeur de l'Opéra de
quat'sous, Kurt Weill.
Rendre les Juifs « exotiques » est perfide en ce sens que de la sorte on
élimine le fait que les cultures juive et celles de l'environnement immédiat
se sont réciproquement influencées, ainsi que l'importance des contributions
apportées par la culture juive lors du modelage des traditions culturelles
régionales – que ce soit en matière de musique, de cuisine, ou de langage. Ce
mécanisme contribue, au moins en Europe centrale, a faire perdurer le
stéréotype du Juif comme « étranger ». A plusieurs reprises au cours des
derniers mois, j'ai demandé à des Allemands non-Juifs, à la sortie du Musée
juif de Berlin, ce qu'ils y avaient découvert. Plus de 90 % d'entre eux
répondirent spontanément qu'il n'avaient pas su que les Juifs étaient présents
depuis si longtemps ( depuis le IVème siècle ) dans les pays de langue
allemande.
L'apparente vitalité des mondes juifs virtuels conduit les profanes à ne plus
ou très difficilement discerner la fiction de la réalité. C'est
particulièrement vrai dans les pays d'Europe de l'Est, dans lesquels se
trouvaient avant la Shoah d'importantes communautés juives.
Dans de prétendus « cafés juifs », on organise des lectures publiques, des
pièces de théâtre yiddish sont mises en scène, on vulgarise la « cuisine juive
» sans qu'un seul Juif y participe, et cela pas seulement à Prague ou à
Kazimierz. Depuis le succès du film « La liste de Schindler », les visites
guidées sur des lieux « authentiques », qui ne sont en réalité pour la plupart
que des lieux de tournage, foisonnent. La fiction et la réalité se mélangent,
se fondent l'une dans l'autre.
Un paysage mental est ici mis en scène, une sorte d'historiographie de
l'émotion, à laquelle chacun peut contribuer en fonction de ses besoins, de
ses humeurs et de ses projections. Une confrontation avec le passé lorsqu'elle
ne se situe pas au niveau de l' identification avec les victimes ou bien une
rencontre avec des Juifs et avec la vie juive sont jugées probablement
indésirables de par l'ambivalence qui les accompagne. Pour la majeure partie
de l'audience non-juive en Allemagne, l'intérêt pour la musique klezmer est
souvent l'expression d'une tentative de se dédouaner vis-à-vis du passé. Les
interprètes non-Juifs y jouent le rôle d'intermédiaires opportuns palliant
l'incapacité ou le peu de disposition des auditeurs à entrer en contact avec
les Juifs de leur voisinage.
Et toujours de nouveau, l'idée de Salut hante le Jewish Disneyland. On y parle
de « l'effet salvateur de la musique klezmer », justification donnée pour
assister à de tels concerts; le journaliste d'un magazine berlinois, posant
une question à l'animatrice américaine Gayle Tufts, quant à son café préféré,
( tenu également par une américaine ), l'amène à dire : « qu'ici aussi, à
proximité immédiate de l'ancien quartier juif de Berlin, on trouve des Bagels,
la spécialité typiquement juive que l'on trouve partout à New York, et que
c'est déjà presque l' indice d'un salut ». Peu de temps après l'achèvement de
la construction du Musée juif de Berlin, un journal quotidien de renom a
exprimé son espoir que ce bâtiment contribue à l'épanouissement d'un effet
salvateur au milieu des friches du paysage urbain. Dans les rues autour du
musée, les destructions de la guerre et les erreurs d'urbanisme qui ont suivi
sont encore visibles aujourd'hui.
Il fut un temps où l'on ne pouvait accéder qu'avec difficulté à la culture
juive : l'éducation juive, qu'elle soit religieuse, historique ou séculaire en
était une condition préalable.
Le Jewish Disneyland est une version allégée instantanée, une sorte de Mc
Donald. Il est fatal que cette variante du Mc Donald soit prise pour un menu
de luxe cinq étoiles. C'est en tout cas plus facile que de connaître le
Siddour ( livre de prières ) ou d'apprendre l'hébreu pour pouvoir lire les
textes anciens en version originale. Après la Shoah, de nombreux juifs de la
seconde génération n'avait guère la possibilité de s'approprier ces domaines,
parce q que ceux qui auraient pu transmettre leur savoir avaient été pour la
plupart assassinés ou conduits à l'exil, et que la génération des parents
était confrontée aux difficultés de la vie, après avoir survécu.
Le Jewish Disneyland fonctionne selon un processus de mise en forme
romanesque, exotique folklorique et historique de ce qui est Juif. En
conséquence la réalité juive devient quasiment invisible. Ces interprétations
fictionnelles du Jewish Disneyland deviennent de plus en plus la norme dans
les médias, en lieu et place de la « culture juive ». Les Juifs réels, qu'il
s'agisse de ceux qui restent ou de ceux qui reviennent, ne peuvent guère
contrebalancer ce phénomène. Ils ne susciteraient que de la déception.
On peut citer ce magazine GOLEM en exemple, dont le premier numéro est paru en
décembre 1999. En vérité, on pourrait penser qu'un magazine juif européen
comme celui-là, qui parait dans la ville où fut décrétée la « solution finale
», ferait sensation et recevrait un écho important. Par oppsition des
réactions positives des médias internationaux et suprarégionaux, les réactions
des médias berlinois ont été très réservées. Un mois avant le GOLEM, un
magazine « style de vie » turque fut mis sur le marché, et un mois après le
quatrième magazine supra régional homosexuel. Dans ces deux derniers cas, tous
les journaux berlinois ont relaté de ces nouvelles parutions.
On peut se demander quelle importance peut représenter le fait que des
non-Juifs se confectionnent leurs propres « mondes juifs ». Les Juifs
peuvent-ils ou doivent-ils se sentir concernés ? Ils pourraient certes essayer
d´ignorer ce phénomène. Mais pour cela, ce phénomène est déjà beaucoup trop
présent.
L´avenir seul nous montrera comment ces mises en scènes
prétendument juives se répercuteront sur les sentiments des Juifs et
influenceront à la longue leur conscience d´eux-mêmes et leur conscience des
autres.
En tout cas, le « Jewish Disneyland » ne contribuera certainement pas à une «
normalisation » des relations entre Juifs et non-Juifs, cette normalisation
dont l´absence est souvent regrettée. Aussi longtemps que l´on réduira les
Juifs à des clichés et que l´on ne reconnaîtra pas la diversité des cultures
juives, la constitution de légendes et la falsification de l´Histoire
persisteront. Celui qui stigmatise les Juifs comme habitants d´un pays
lointain ou comme étrangers occulte le fait suivant : la majorité des Juifs
qui ont été déportés d´Allemagne n´étaient pas des juifs d´Europe de l`Est,
mais au contraire des gens qui se considéraient comme « citoyens allemands de
confession judaïque », et, parce qu´ils vivaient dans ce pays depuis des
siècles, ne pouvaient pas s´imaginer ce qui allait leur arriver. Ils étaient
des voisins, des collègues de travail, des amis, des connaissances ou des
relations d´affaires et faisaient partie de la vie quotidienne. Une nouvelle «
simplicité » dans la relation réciproque ne pourra pas se développer si les
Juifs doivent d´abord travailler à éliminer les clichés, les erreurs de
jugement et les quiproquos dont on les accable.
Traduit par Philippe Richer
Iris Weiss vit à Berlin. Elle a fait des études de pédagogie et d'études
sociales. Travaille en tant que journaliste et dans la formation pour adultes.
Elle est spécialisée dans le présent et le passé de l'histoire juive
berlinoise, et propose de nombreuses visites guidées, entre autres sur le
thème « Jewish Disneyland ». Son site Internet (anglais/allemand) se trouve à
l'adresse suivante :
www.berlin-judentum.de.
|